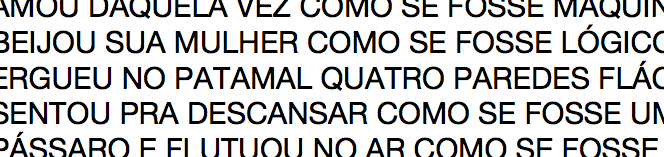La pudeur
C’est le matin et je marche sur la track. Le soleil encore bas trace l’ombre de la clôture dans la neige bien tapée. Personne devant, personne derrière, l’air froid me saisit, je mets de la musique dans mes oreilles. C’est bon, mais ce n’est pas la bonne musique, j’ai envie d’entendre une voix humaine. Je pense tout de suite à Chico Buarque. Je décide d’écouter Construção, un chef-d’œuvre absolu à tous les niveaux, le genre de pièce que tu commences dans un état que tu crois être le tien et que tu termines dans un état que tu ne savais pas être le tien.
Ce matin, justement, je ne me doute de rien. Je vais bien comme on va bien en pandémie, je vais bien par pudeur. Je suis contenue, bien contenue dans ce contenant qui me semble être la seule façon de survivre à ce qui nous arrive. Un jour à la fois et on verra bien, dit le contenant, fais de ton mieux, dit le contenant, ne pense pas trop en avant, insiste le contenant.
Chico Buarque est brésilien et je comprends sa langue. J’ai écouté cette chanson souvent, j’en ai même déjà lu les paroles, je sais que ce sont les mots d’un immense poète. Mais ce matin, dans l’air froid qui me saisit, le texte trouve vers moi un chemin qu’il n’a jamais pris.
Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
Je comprends.
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Je comprends. Je marche et j’écoute et c’est si beau. Je ne sais même pas que je pleure, après tout je pleure tout le temps, dehors, l’hiver, à cause du vent.
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago
Dançou e gargalhou como se ouvisse música
Je passe le viaduc Rosemont quand il devient clair que ce ne sont pas les larmes du vent.
Agonizou no meio do passeio público
Morreu na contramão atrapalhando o tráfego
Je viens de passer la rue St-Laurent quand je pleure soudain tellement qu’il faut que j’arrête de marcher. Mon corps est traversé par les sanglots, le monde s’arrête. Personne devant, personne derrière, je suis avalée par la musique et je me laisse avaler par elle, et cette violence soudaine des émotions est d’une douceur sans nom.
Quand je reviens enfin à moi, je me dis qu’il faut que cesse cette pudeur de vivre. Nous ne sommes pas faits pour nous contenir à ce point. Nous ne sommes pas faits pour nous taire. Nous sommes brisés par le silence. Et par «silence» j’évoque le vide contenu dans l’éternelle répétition des statistiques. J’évoque les timides nouvelles que nous nous donnons et le mensonge des phrases courageuses qui finissent toutes par «dans les circonstances». J’évoque l’absence devenue dangereuse de toute forme d’art vivant. J’évoque la rigidité de cette pudeur qui nous retient de hurler. Nous avons besoin de bruit. Nous avons besoin de cesser de nous contenir.
J’ai continué mon chemin et rue Bélanger des moineaux dans un arbuste chantaient à tue-tête. Écrire ici ce soir, pour moi, c’est faire comme eux.