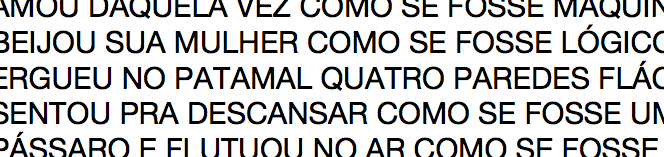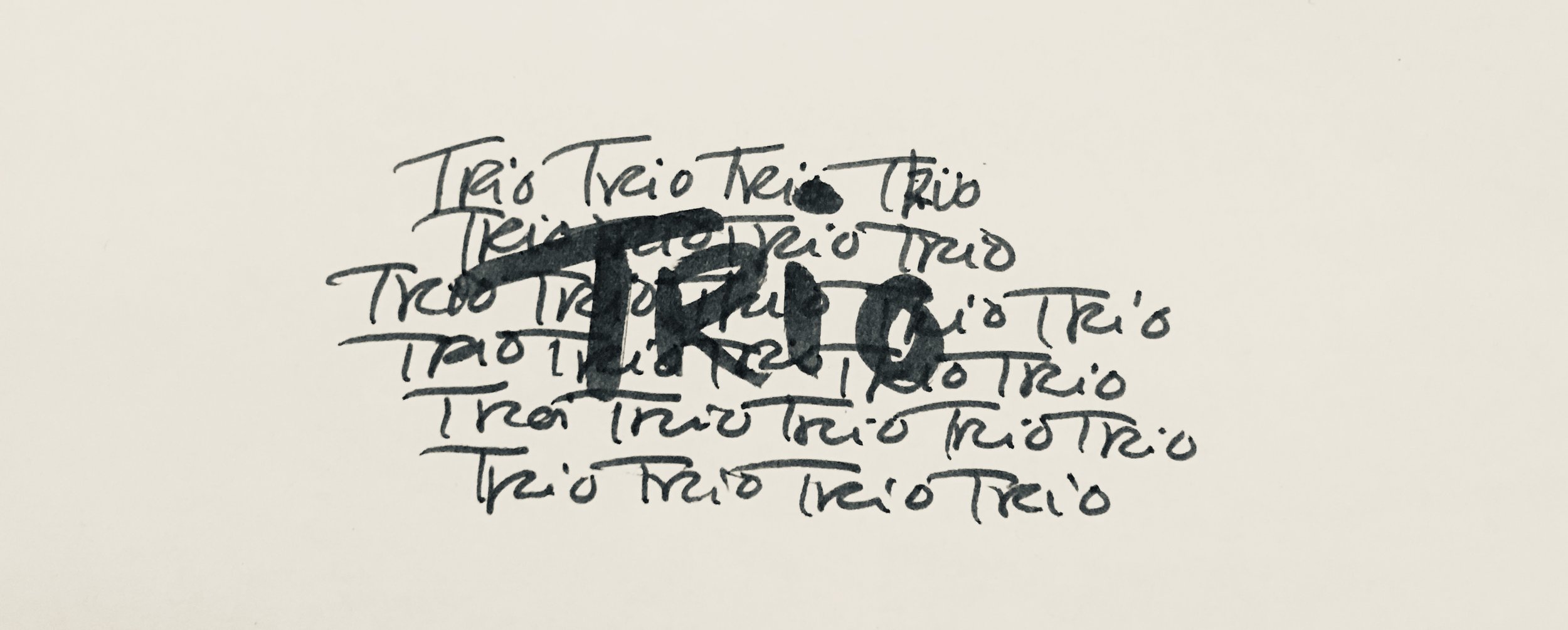Au mois de novembre, l’angoisse m’est tombée dessus avec fracas.
Me voilà donc, après moult visites chez l’homéopathe, le naturopathe, l’acupuncteur, l’ostéopathe et la psychologue, débarquée dans le bureau beige et sans fenêtres d’un psychiatre moustachu portant lunettes qui s’apprête à poser un diagnostic de trouble anxieux. Ceux qui me connaissent ne sont pas plus surpris que moi.
Conversation.
Lui: Que puis-je faire pour vous madame.
Moi: J’ai un trouble anxieux.
Suivent plusieurs minutes de données confidentielles grâce auxquelles, cher lecteur chère lectrice, nous pouvons tout de suite aller à l'essentiel.
Lui: Le nom de votre mère…
Moi: Baillargeon.
Lui: Votre père…
Moi: Courchesne.
Lui: Ah c’est drôle, complètement québécoise alors.
Moi. Euh, oui?
Lui: Vous êtes vraiment très typée pourtant.
Moi: On m’a dit ça oui.
Lui: De l’amérindien peut-être?
Moi: Quelqu’un a certainement du coucher avec quelqu’un un moment donné oui.
Lui: Quelle tribu?
Moi: Je ne sais pas.
Lui: Ah bon, ça ne vous intéresse pas?
Moi: Euh…
Lui: Et vous faites du jazz.
Moi: Oui.
Lui: Et dans votre jazz trouve-t-on des influences amérindiennes?
Comme il a de la moustache, des lunettes, et qu’il m’a dit être psychanalyste en plus de psychiatre, comme, bref, il a l’air sérieux, mon incrédulité ne cesse de croître. La pièce sans fenêtres me joue-t-elle des tours? Où suis-je? Dois-je vraiment répondre à cette question?
Moi: Euh non… c’est… du jazz… euh…
Lui: Moderne?
Moi: non…. Du jazz… euh…
Lui: Classique alors.
Moi: Disons ça oui.
Un doute s’installe: il me semble que quelque chose cloche qui n’est pas uniquement dû à mon trouble de l'anxiété.
Suivent bien d’autres données confidentielles qui nous amènent au point culminant de la conversation. Tout est terminé: je suis bel et bien anxieuse; il suggérera à mon médecin un médicament à prendre si je sens que j'en ai besoin. Puis-je faire autre chose pour vous madame, non monsieur, merci beaucoup. Puis il me dit.
Lui: Quelque chose me chicote tout de même.
Moi: Ah bon.
Lui: Nous avons parlé de votre manque de confiance, adolescente. Maintenant, que faites-vous pour améliorer votre estime physique de vous?
Moi: (silence)
Lui. Parce que (il fait un grand geste de la main, me désignant dans mon intégralité) je peux voir que vous n’êtes pas très coquette.
Moi: (stupeur)
Lui: Bon vous me direz, ce n’est qu’une visite chez le médecin, mais tout de même…
Moi: (stupeur)
Lui: Vous arrive-t-il de dépenser de l’argent pour acheter des vêtements, des cosmétiques…
Moi: (stupeur)
Lui: Vous savez l’image des femmes est très importante dans la société.
Moi: (stupeur)
Lui: Dans votre milieu, vous devez être en contact avec des coiffeuses, des maquilleuses… elles peuvent vous donner des conseils, vous savez, souvent l’image que l’on a de nous-même est erronée, des professionnels peuvent avoir un bon recul!
Moi: STUPEUR.
Son ton est celui d’un bon père de famille. Il se dit probablement qu’il m’aide. Pendant qu’il se dit qu’il m’aide, moi je me dis ah voilà ce qui clochait! C’est un con en fait! Et je regrette aussitôt toutes les données confidentielles versées en toute confiance dans son oreille poilue.
Ensuite, je m’en vais.
Je ne suis pas moins angoissée.
C’est encore le mois de novembre.
Moi et mon manque de coquetterie allons nous promener dans la rue. Il fait noir, et quelque part dans un local beige et sans fenêtres, quelqu’un qui a des diplômes, une moustache, des lunettes et une opinion sur le jazz amérindien donne à des patients fragiles des conseils des années 50.